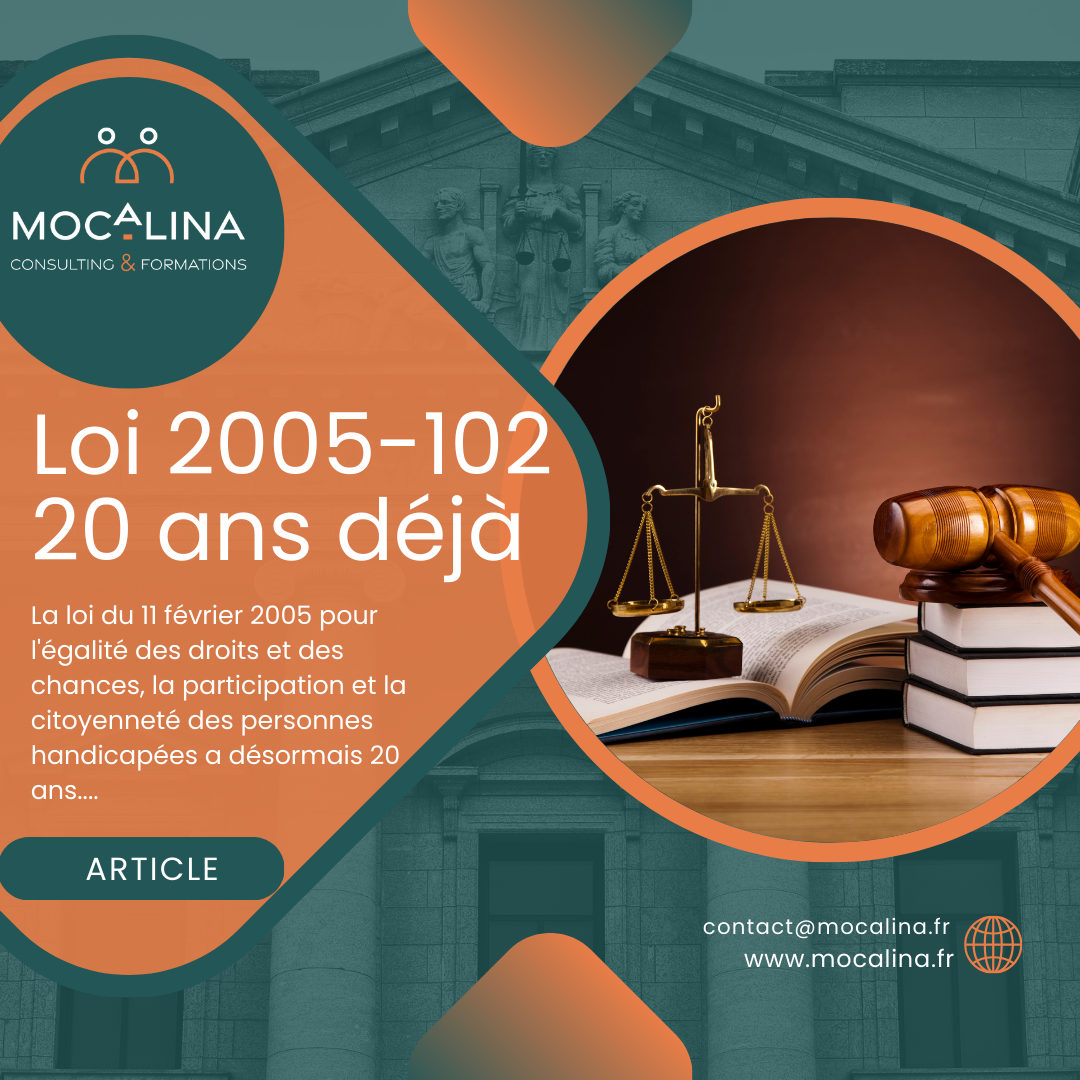
La loi “handicap” de 2005 a désormais 20 ans.
- Catégories Général
- Date 6 février 2025
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a désormais 20 ans…. Ce texte d’une centaine d’articles touche une quinzaine de codes différents :
“Code de l’action sociale et des familles, mais aussi, à des degrés divers, le Code de l’éducation, le Code de la santé publique, le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’urbanisme, le Code général des impôts, le Code civil, le Code électoral, le Code général des collectivités territoriales, le Code de procédure pénale, le Code des assurances et même le Code des marchés publics et le Code rural” (Calin, 2005).
Mais pourquoi cette loi ?
Les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres. Comme l’indique Murielle Mauguin, directrice de l’INSEI dans un webinaire organisé par la Fnaseph du 24 octobre 2024 sur le droit commun et le droit spécifique : les personnes handicapées entrent normalement dans le droit commun, mais comme cela n’a pas eu l’effet escompté, il y a eu une obligation de faire une loi spécifique. (Mauguin, 2024). Cette loi englobe donc tous les aspects du droit commun en prenant en compte les besoins spécifiques et les particularités des personnes en situation de handicap.
Quels changements visait cette loi ?
Cette loi était et est toujours très ambitieuse car elle apporte une vision transversale sur la prise en compte du handicap dans différents domaines. Elle était attendue depuis de nombreuses années par les personnes en situation de handicap et leurs familles. L’objectif affiché de la loi est que le handicap, avec toutes ces spécificités et particularités proposent une amélioration de la participation sociale en mettant en place des droits adaptés aux situations particulières, notamment grâce à la prise en compte des défaillances de l’environnement.
Il est intéressant de noter, comme l’indique Calin, que pour la première fois de l’histoire de la législation française, une définition du handicap a été proposée. Elle a fait l’objet de nombreux débats et discussions par les associations qui ont réfléchi à cette définition. (Calin, 2005)
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. “
La loi du 11 février 2005 a marqué une étape majeure dans la politique du handicap en France. Son ambition est d’établir une égalité réelle des droits et des chances en plaçant la personne handicapée au cœur des décisions la concernant. Elle vise à favoriser l’inclusion, la participation et l’autonomie des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la société. Avant cette loi, le handicap était surtout perçu sous l’angle de l’assistance. L’ambition de 2005 était de passer d’une logique de solidarité à une logique de droits, où chaque personne handicapée peut exiger l’accès aux mêmes opportunités que les autres citoyens. L’un des messages clés de la loi était d’affirmer que c’est à la société de s’adapter aux personnes en situation de handicap, et non l’inverse afin de favoriser la pleine participation.
Des textes règlementaires d’applications pour faire appliquer cette loi
Des dizaines de décrets, d’arrêtés et de circulaires ont été rédigés pour faire appliquer cette loi dans différents domaines : éducation, accessibilité, emploi, études supérieures, formations, apprentissages, établissements sociaux et médico-sociaux. Peu de secteurs n’ont pas leur texte d’application. Dans l’ensemble, elle couvre tous les domaines. Et même si certains textes devraient évoluer un peu car la société à évoluer en 20 ans, cette loi et ses textes d’applications restent d’actualités. Voici quelques exemples :
- Création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) : Ce sont des guichets uniques pour l’accueil, l’information, l’accompagnement et la reconnaissance des droits des personnes handicapées.
- Droit à la compensation : Mise en place de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), permettant de couvrir les surcoûts liés au handicap en fonction du projet de vie de la personne.
- Scolarisation en milieu ordinaire : Droit reconnu pour les enfants en situation de handicap à être scolarisés en milieu ordinaire, avec les aménagements nécessaires. Des dispositifs ont été mis en place pour essayer de faciliter ce droit.
- Aménagements des épreuves à l’université : des services et des dispositifs ont été créés pour proposer des aménagements aux étudiants en situation de handicap, pendant les cours et lors des passages des examens.
- Accessibilité : Obligation d’accessibilité pour les bâtiments, transports, voiries et espaces publics, afin de garantir une participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie sociale.
- Etc.
Le bilan
De nombreuses choses ont été mises en place, mais il faut bien admettre qu’il reste tant à faire. Nous sommes bien loin de l’égalité des droits et des chances ! Même si la majorité des objectifs de cette loi restent pertinent, leur mise en œuvre est bien souvent insuffisante, voire inexistante. La participation sociale optimale est loin d’être une réalité pour les personnes en situation de handicap. L’accès aux droits est encore très compliqué et la discrimination est une réalité. Le handicap reste d’ailleurs la première cause de discrimination en France. On constate également des échecs, voire des reculs sur certains textes et objectifs de bases. Par exemple, l’accessibilité du cadre bâti qui promettait des facilitateurs est un échec. Combien de commerce, de lieux sont encore inaccessibles à tous. Et il n’est pas question ici que de l’accès en fauteuil roulant, mais bien à tous les handicaps. Les transports en commun ne sont souvent pas aux normes, comme le métro de Paris par exemple, ou encore le train. Savez-vous que dans la majorité des cas, une personne en fauteuil roulant ne peut pas accéder aux toilettes des trains ? Eh oui, en 2025, les toilettes sont inaccessibles pour une partie de la population. Vous accepteriez cette situation ?
Certains textes très ambitieux ont fait marche arrière, c’est le cas du pourcentage des logements neufs qui devaient être adaptés ou adaptables. Leur nombre à chuter, empêchant une partie de la population de trouver un logement, ou de pouvoir déménager et vivre où bon lui semble. Sans compter que le manque d’accessibilité des logements prive une partie de la population de liens sociaux. Comment rendre visite à un proche s’il est impossible d’accéder à son domicile ?
Il existe encore de nombreux services qui excluent les personnes à besoins particuliers. Prendre une place de concert nécessite encore de téléphoner à un service spécifique, au lieu de pouvoir accéder aux places dans une salle virtuelle, comme toutes les autres personnes. La représentation du handicap est toujours un sujet d’actualité à expliquer. Il est important de continuer à informer les gens, car l’image du handicap reste négative, avec un regard de compassion qui amène à une position de charité, voire un regard anxiogène et les études scientifiques sur le sujet le prouvent (dernière étude sur le sujet publiée en janvier 2025).
La complexité administrative est une véritable barrière pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Les démarches pour accéder aux droits et aux prestations demeurent complexes, entraînant des retards et des inégalités dans l’accès aux services. Les familles rencontrent toujours des difficultés à identifier les leviers qui peuvent les accompagner dans leurs démarches.
En 2025, près de 20 ans après la loi 2005-102, la question reste de savoir comment renforcer ces ambitions et accélérer leur mise en œuvre. Les personnes handicapées souhaitent que l’on respecte leurs droits et aspirent à une participation sociale totale. Alors, combien d’années vont-elles devoir encore attendre ?
Références
Calin, D. (2005) . Comprendre la loi de février 2005 sur les droits des personnes handicapées. Enfances & Psy, no 29(4), 191-200. https://doi.org/10.3917/ep.029.0191.
Mauguin, M (2024). Webinaire de la Fnaseph, “Droits commun et droits spécifiques. Webinaire 5 : recours administratif et juridiques – défendre le droit à la scolarisation, 24 octobre 2024”. En savoir plus : cliquez ici
Master 2 - Pratiques Inclusives, handicap, accessibilité, accompagnement. Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à besoins éducatifs particuliers (BEP)
Titre Professionnel : Formateur Professionnel Pour Adultes.
+ 20 ans d'expérience dans le domaine du handicap, de l'accessibilité.
De nombreuses expériences professionnelles dans le public, le privé et associations différentes. Dont 7 ans comme instructrice accessibilité dans un service dédié au cadre bâti.
Savoirs expérientiels.
Vous pourriez aussi aimer
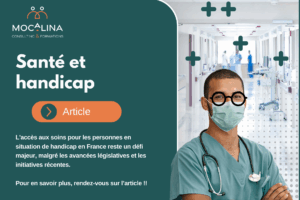
Handicap et soins



